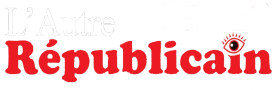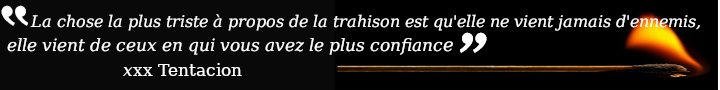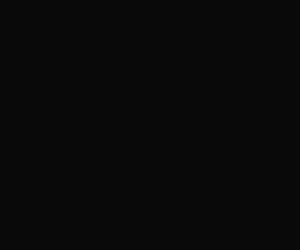Chacun a son temps et peut-être chacun est-il son temps. Même le sage a dit qu’il y a un temps pour tout et tout pour un temps. Les calendriers, les saisons, les horloges et, dans une certaine mesure, les cimetières, sont inventés ou acceptés comme des tentatives pathétiques de mesurer le temps. Une opération nécessaire lorsqu’il s’agit de voyager dans les transports publics, d’organiser des anniversaires, de célébrer des événements ou simplement de se souvenir d’événements passés. C’est le temps officiel, qui ne coïncide évidemment pas du tout avec le temps personnel, qui apparaît comme un mystère incalculable parce qu’il baigne dans l’éternité.
Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour chaque chose sous les cieux. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour déraciner. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s’abstenir d’embrasser. C’est ce qu’a médité et écrit le sage Qoelet.
Le Sahel, cet espace particulier de l’Afrique subsaharienne dans lequel j’ai eu le privilège de vivre, a et est son propre temps. Dicté, pour la plupart, par l’aventure quotidienne de la survie et des années d’actions déstabilisatrices des Groupes Armés Terroristes, appelés bandits par ceux qui subissent leurs exactions. Ils sont des centaines de milliers à avoir vu leur temps occupé par la peur, confisqué par les armes et vendu aux entrepreneurs de guerre. Il y a le temps suspendu des enfants car les groupes armés ont forcé la fermeture de 13 250 écoles et, selon l’UNICEF, quelque 2,5 millions d’écoliers sont exclus du processus éducatif. Ce sont les enfants des agriculteurs.
Le temps des paysans, dans les zones touchées par le conflit importé, est entre les mains d’autres personnes qui décident arbitrairement qui peut rester au village, cultiver, payer des impôts aux bandits et ne rien savoir du lendemain. Un temps exproprié qui, ajouté à celui des personnes vivant dans les camps de déplacés, constitue comme une passerelle entre un passé qui ne reviendra jamais et un avenir encore incertain. Un temps suspendu entre l’attente de nourriture, de médicaments et de conditions de vie décentes et la peur de perdre le peu de vie qui reste sous le regard des politiques.
Les rues de la capitale Niamey sont une métaphore quotidienne des temps qui unissent et divisent les citoyens. Il y a le temps des voitures diplomatiques ou des voitures de ministres, celui des ambulances qui annoncent l’urgence, celui des milliers de taxis qui s’arrêtent brusquement. Il y a le temps des dromadaires qui rythment le pas des chauffeurs de grumiers et, enfin, le temps des ânes qui tirent la charrette omniprésente à coups de bâton intermittents. Il y a le temps des feux tricolores qui fonctionnent en semaine ou les jours fériés et le temps des vendeurs d’oiseaux verts en cage.
Il y a le temps des militaires au pouvoir dans l’Alliance des Etats du Sahel, l’AES. Un temps rassurant parce que fixé à cinq ans de gouvernement et peut-être renouvelable ou modifiable en fonction des circonstances à venir. Un temps de promesses qui, comme toujours en politique, engagent surtout ceux qui les écoutent et donc un temps militarisé par des armes, des uniformes et des grades à distribuer à volonté aux méritants. Quant au temps des pauvres, unique en son genre, personne ne s’en soucie et personne ne pourrait le définir. Un temps suspendu entre silences, souffrances et espoirs infimes.
Sous le soleil du Sahel, il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour chérir et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix, ainsi méditait et écrivait le sage Qoelet.
Mauro Armanino, Niamey, avril 2025